
Voici le discours de présentation prononcé par l’auteur Gabriel Badea-Päun lors de la présentation de son dernier livre consacré à la reine Elisabeth de Roumanie, de son nom d’artiste Carmen Sylva. Née princesse de Wied en 1843, la princesse épouse en 1869 le prince Karl de Hohenzollern-Sigmaringen qui deviendra le roi Carol I de Roumanie. Un portrait d’une reine pas comme les autres (Merci à Gabriel – Copyright photos : DR)
Il y a cent ans Carmen Sylva, alias Elisabeth, reine de la lointaine Roumanie, faisait fréquemment la une de la presse française. Même s’il est difficile de le croire aujourd’hui, ses actes, interviews, photos ou articles comblaient de bonheur les revues people de ces temps là pour lesquelles elle incarnait la reine artiste. Sa renommée était si grande, un vrai brand, comme on le dirait aujourd’hui. On donna son nom à plusieurs objets vendus dans le commerce, vêtements, tissus, ou plats culinaires, à une valse, à un large territoire de la Terre de Feu, grâce à l’explorateur roumain, Jules Popper, à des poupées habillées dans des costumes populaires roumains ayant ses traits. Des sociétés artistiques, orchestres folkloriques, dont une étonnante l’Orchestre Internationale de Tzigannes Carmen Sylva activant à Zwickau (dans l’Est de l’Allemagne) ou même une loge franc-maçonnique portaient son nom. Dans l’Angleterre victorienne les jeunes filles de bonne famille qui voulaient se rendre intéressantes étaient apostrophées avec un : « Don’t make your Carmen Sylva ! »
La reine Elisabeth de Roumanie ne se satisfit pas en effet d’un anonymat doré imposé par cette Europe monarchique qui comptait à l’époque pas moins de dix-sept reines et des cohortes de princesses dont seules la beauté et l’importance du trône étaient les principales qualités requises pour faire parler de soi. «Elle n’avait jamais passé pour une beauté », écrivait dans son journal la future reine Marie de Roumanie, « mais il se dégageait d’elle un charme ensorcelant dont il était impossible de ne pas subir la fascination, au premier abord du moins. Jeune encore, elle avait déjà les cheveux tout blancs, mais le regard de ses yeux intensément bleus vous pénétrait. Elle riait souvent et laissait voir des dents d’une blancheur éclatante ; mais son rire contrastait d’une manière frappante avec l’expression tragique de ses yeux. Ce pathétique, ce je ne sais quoi de tragique qui émanaient d’elle, donnaient à tous ceux qui l’approchaient le désir d’alléger le fardeau qu’elle portait. Elle n’inspira pas de passion, mais elle sut se faire admirer.»
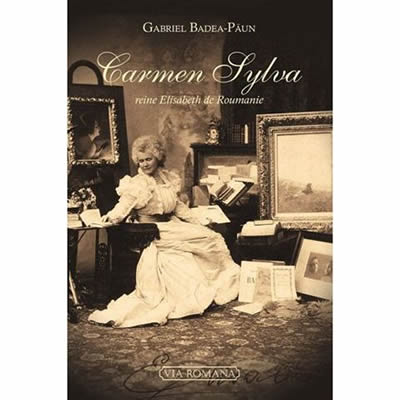
Elle bâtit son personnage, aux nombreuses contradictions, avec une énergie tendue jusqu’au bout vers ce qu’elle croyait être le vrai bonheur : Celui d’une reine – écrivain à succès, protectrice des arts et des lettres. On reconnaît facilement dans cette image Aliénor d’Aquitaine, Elisabeth de Hongrie ou Marguerite de Valois, modèles romantiques mis au goût du jour par l’intérêt archéologique des historiens. Elle n’était pas la seule à emprunter ce chemin. Victoria d’Angleterre publia un volume de mémoires; Elisabeth d’Autriche-Hongrie écrivait elle aussi, en cachette toutefois. C’était une habitude fréquente chez les jeunes princesses allemandes de s’exercer à faire des rimes, mais Elisabeth de Roumanie passa outre ces limites. Elle prit un pseudonyme, bientôt cependant dévoilé : Carmen Sylva, (le chant de la forêt), dont les consonances latines évoquaient celles de ses sujets, et elle commença à publier avec une régularité bien allemande deux à trois volumes par an. Plus d’une cinquantaine de volumes parurent ainsi en même temps que des centaines d’articles dans toute la presse européenne.
Ses ouvrages – dont certains de vrais best-sellers – furent traduits en plus d’une dizaine de langues, y compris l’espéranto, et couronnés de prix par les académies du monde entier dont l’Académie française, pour ses Pensées d’une Reine, parus en 1888 chez Calman Lévy. Ils lui attirèrent l’amitié de personnages célèbres. Impressionné par ses œuvres, Pierre Loti en traduisit quelques unes et la rencontra à plusieurs reprises. Frédéric Mistral la nomma reine de ses Félibriges. Catulle Mendès, Octave Feuillet, Sully Prudhomme, Leconte de Lisle et Guy de Maupassant se déclaraient heureux de se voir traduits en allemand par elle. Charles Gounod lui proposa de mettre en musique les vers de son cantique, La Trinité, mais il mourut avant d’avoir réalisé son rêve. Camille Saint Saens lui dédia une fantaisie pour orgues. Emile Gallé créa pour elle de magnifiques vases et Aristide Maillol des étonnantes tapisseries Nabi.

La reine Elisabeth avait en outre un grand sens de la communication moderne. Elle adressait de nombreuses missives à des gens très connus qui furent souvent ses laudateurs. Mais l’hommage le plus touchant vint peut-être d’un peintre maudit par la société et qu’elle n’a pourtant jamais rencontré. Seul et loin de sa famille, enfermé dans une maison d’aliénés, Vincent van Gogh trouva quelque soulagement moral à ses atroces douleurs physiques dans ses Pensées royales qu’il évoqua souvent dans ses lettres à son frère Théo.
Le succès des premières œuvres de la reine fut rapidement suivi par une transformation quasi totale de son image. Ainsi écrivait-elle dans ses Pensées : «La toilette n’est pas une chose indifférente. Elle fait de vous un objet animé, à condition que vous soyez la parure de votre parure.» Ses costumes étaient souvent considérés par ses proches ou ses hôtes comme de vraies hardiesses de star. Des robes-tuniques blanches, inspirées par Sarah Bernhardt, étaient agrémentés de bijoux imposants et de peu de valeur, ainsi que de toutes sortes de dentelles ou broderies inattendues.
Pour ses apparitions publiques elle avait imaginé une scénographie digne d’un metteur en scène professionnel. Son public la «surprenait» souvent en train d’accomplir l’une de ses occupations favorites. Dans son journal, la future reine Marie raconta la visite qu’elle lui fit à la veille de son mariage avec le prince héritier Ferdinand : «La mise en scène avait été certainement étudiée. La lumière tombait du plafond, elle était enveloppée de blanc et adossée à ses coussins neigeux, sa voix musicale, ses gestes larges et accueillants, l’éclat de ses dents éclairées par un sourire lumineux, l’expression tragique de ses yeux d’un bleu intense, tout avait produit l’effet attendu…On eût dit que, par une tendance naturelle de son esprit fantaisiste, elle se croyait toujours en représentation…. elle prenait le monde pour un vaste théâtre. Elle voyait toute la vie comme une série de scènes de drame où elle jouait le personnage principal ». Un jour Réjane, en visite à Bucarest, a eu ce mot pour elle « Majesté, mais vous avez tout ce qu’il faut pour devenir sociétaire de la Comédie française. »
La voix était en effet un autre de ses points forts. Sa prononciation chantante et caressante, maîtrisant avec la même facilité quatre langues (allemand, français, roumain et anglais) ensorcelait son auditoire. Ses enregistrements pour la maison de disques His Master’s Voice en sont la preuve aujourd’hui.
Confite dans l’admiration de toute l’Europe, visitée comme un monument par tous ceux qui arrivaient dans cette lointaine contrée plus proche de l’Orient que de l’Occident, Carmen Sylva, dans son rôle de composition était fort éloignée du jeu protocolaire de la reine ou de celui, trop étouffé, de la femme. Ses contemporains ont pourtant préféré ses deux premiers rôles, même si la femme exprimait ouvertement sa véritable identité. Au reste la reine subit ses obligations sans se révolter, accomplissant un devoir qu’elle s’était engagée à respecter lors de son mariage; c’était, en quelque sorte son contrat d’embauche. Elle le négligea une seule fois quand, aveuglée peut-être par son romantisme mais aussi par certaines considérations nationales, elle voulut marier le prince héritier Ferdinand à sa protégée, Hélène Vacaresco.
Derrière l’écrivain à succès, la reine cachait une femme triste, souvent déprimée. Dans ses pensées intimes, Elisabeth se déclarait, tout comme Sissi, républicaine : «Je ne puis que sympathiser avec les sociaux-démocrates ». Etait-ce juste un pied de nez qu’elle adressait à la classe politique roumaine qui ne l’aimait pas ? Peut-être, mais pour la femme Elisabeth, les conventions n’étaient pas très importantes. Par exemple, si elle participait aux cérémonies religieuses orthodoxes, catholiques ou protestantes, comme son devoir de reine et d’épouse le réclamait, elle fut cependant la première à soutenir moralement et financièrement la Société théosophique lors de sa création.
En tant que femme, Elisabeth avait toujours rêvé, de jeter le masque avant sa mort et de relater une fois pour toute sa véritable existence, avec la plus effrayante sincérité : «On a tant écrit sur ma vie extérieure et on sait si peu de ma vie intime ! Mais qui peut raconter sa vie d’une façon qui semble fidèle à tous ? On n’apparaît pas la même à tel homme et à son voisin. Je suis autre pour ma femme de chambre que pour mes amis, autre pour les Roumains et autre pour les Américains. Si j’avais eu le temps de l’écrire, cette biographie, j’aurais surtout parlé de mon enfance, car les petits traits caractéristiques de nos débuts sur terre expliquent toujours toute la vie ultérieure, et j’estime qu’on ne change jamais. » En 1905 elle avait ainsi commencé des mémoires, mais après la parution en 1907 du premier volume intitulé Mein Penatenwinkel (Mes pénates), on a trouvé qu’il était inconvenant de les continuer : le manuscrit du deuxième tome disparut avant même que l’auteur s’en aperçût.
Ecrire une biographie de Carmen Sylva se révèle être une entreprise périlleuse. Sa vie fut, on le sait, abondamment commentée par ses contemporains : non loin d’une trentaine de biographies et des centaines d’articles la concernant parurent dans toute l’Europe, fourmillant d’anecdotes qui finissent par engloutir le personnage. La dernière en français écrite par le diplomate Georges Bengesco est parue à Bruxelles en 1905. Il y a la vie de l’auteur, telle qu’elle la rêve et la bâtit, il y a la narration de cette vie, faite par des spécialistes, des amis, des admirateurs ou des courtisans qui ont pour ambition d’en dégager le sens. Scruter les biographies revient donc à étudier le mythe, à se demander ce qu’il signifie et à s’interroger sur sa persistance. En 1939, une anglaise, Elisabeth Burgoyne, repartant à la découverte du mythe, fut fascinée par l’intelligence et la tristesse de cette femme attachante. Cependant sa biographie, une vraie réussite, fut vite oubliée la guerre venant d’éclater. Depuis rien ou presque rien…
Et pourtant la vie de Carmen Sylva intéresse toujours. Sur la toile plusieurs sites lui sont dédiés. Deux thèses de doctorat concernant son œuvre littéraire furent récemment soutenues. Les féministes américaines et allemandes n’ont cessé d’admirer la modernité et l’exemplarité de cette femme qui, à contre courant de la société de son temps, a fait souffler un vent de liberté dans les mœurs du XIXème siècle. La reine Elisabeth n’est pas seulement en avance sur son époque parce qu’elle s’est érigée en protectrice des artistes ou encore parce qu’elle a su utiliser son personnages pour mieux diffuser ses créations. Elle a revendiqué et démontré l’égalité des sexes dans la création artistique, mettant à profit sa position pour faire progresser cette idée dans la haute société, non seulement dans son propre pays mais encore dans l’ensemble de l’Europe. Elle a su gérer socialement, en permanence, sa situation paradoxale et son anti-conformisme, tout en respectant, quand cela lui semblait nécessaire, les rites d’une société qui lui reconnaissait sa qualité de reine. Mais cette modernité de comportement n’a curieusement été d’aucune influence sur son œuvre. Force est de constater que, face à la postérité, ce même caractère qui avait donné naissance à un personnage hors du commun a dévoré ses propres œuvres sur lesquelles elle avait cru pouvoir compter pour assurer sa mémoire.
Après sa disparition l’image de la reine Elisabeth s’estompa graduellement laissant la place à la construction d’une autre, celle de la nouvelle reine Marie, la reine guerrière, celle de l’épopée de la réalisation de la Grande Roumanie. Dans l’imaginaire roumain de l’entre- deux-guerres son souvenir fut surtout associé à son action culturelle et parfois à son romantisme qu’on trouvait alors ridicule dans ses excès. Le régime communiste installé en 1948 détruisit ses effigies, ses portraits peints et sculptés : s’ils ne furent pas anéantis, ils furent enfouis dans les réserves des musées d’où ils devaient ne jamais ressortir. Il interdit aussi toute références à son œuvre littéraire classée dans des fonds de bibliothèques spéciaux inaccessibles. Les rarissimes fois où son nom était mentionné étaient généralement en relation avec le généreux mécénat dont elle fit profiter le compositeur Georges Enesco. Cependant, lors des restitutions historiques qui suivirent les événements de 1989 sa figure resurgit. Plusieurs de ses volumes furent publiés, des expositions, des thèses lui furent consacrées. Une nouvelle image, peut-être plus sereine, plus proche du rôle qu’elle joua est en train de naître.
14 juillet 2011 @ 06:18
Je pense qu’il serait plus juste de l’appeler « Élisabeth de Wied, reine de Roumanie, alias Carmen Sylva ».
Ceci dit, l’article est très intéressant.
14 juillet 2011 @ 07:37
Vous avez raison Actarus
15 juillet 2011 @ 03:11
« De son nom d’artiste » est une très jolie formule, bien mieux qu’alias.
Bravo Régine, et merci.
14 juillet 2011 @ 08:17
Merci Gabriel, merci Régine, cet article a dû être long à recopier, mais comme il valait la peine !
Je découvre une reine que je ne connaissais pas et c’est juste passionnant.
14 juillet 2011 @ 11:01
Merci Gabriel pour ce portrait d’une reine de Roumanie dont l’histoire a été, selon moi, fortement occultée par la personanlité de la reine Marie de Roumanie.
14 juillet 2011 @ 12:59
Elle n’avait eu qu’une seule petite fille, Maria, née en 1870 et morte de scarlatine à 3 ans.
14 juillet 2011 @ 13:18
Que je presque oublie! Vine la France!
14 juillet 2011 @ 14:12
Merci pour cet éclairage sur la vie de la reine Elisabeth de Roumanie.
14 juillet 2011 @ 14:23
merci beaucoup Gabriel
article très interressant
14 juillet 2011 @ 18:20
très beau portrait, merci Régine et Gabriel.
si vous le permettez voici quelques photos de la reine
http://i1183.photobucket.com/albums/x466/patlo1/EdR6.jpg
http://i1183.photobucket.com/albums/x466/patlo1/EdR12.jpg
http://i1183.photobucket.com/albums/x466/patlo1/EdR20.jpg
http://i1183.photobucket.com/albums/x466/patlo1/EdR19.jpg
http://i1183.photobucket.com/albums/x466/patlo1/EdR15.jpg
http://i1183.photobucket.com/albums/x466/patlo1/EdR16.jpg
http://i1183.photobucket.com/albums/x466/patlo1/EdR5.jpg
14 juillet 2011 @ 19:08
A Gabriel,bien merci pour votre beau article bien documente sur Elizabeth de Wied! Si nous savons qu’elle est la fille du prince Hermann de Wied,qui est sa mere? Avait-elle des freres et soeurs? Comme elle avait perdu sa fille unique,elle voulait donner un vrai sens a sa vie personnelle en se consacrant aux activites qui la rendent heureuse!
14 juillet 2011 @ 22:57
Caroline
la mère était Marie,princesse de Nassau-Weilburg(1825-1902 )
Elle était l’aînée d’une fratrie de 3 enfants,donc 2 frères suivaient
1)-Wilhelm(1845-1907 )marié avec Marie,princesse des Pays-bas (1841-1910 )
6 enfants…donc la descendance jusqu’à nos jours
2)-Otto(1850-1862 )
15 juillet 2011 @ 12:52
Wilhelm de Wied avait été élu prince souverain d’Albanie, Vidit Ier. Règne qui n’a duré que 8 mois de février à septembre 1914.
4 septembre 2011 @ 16:15
Ce n’était même pas 6 mois: monté au trône le 7.3.1914, part d’Albanie le 5.9.1914.
Voir aussi: Duncan Heaton-Armstrong, The Six Month Kingdom: Albania 1914, 2005.
4 septembre 2011 @ 16:18
PS: il s’agit de Wilhelm (1876-1945), fils de Wilhelm 5ème Fürst de Wied (1845-1907) et de Marie des Pays-Bas
15 juillet 2011 @ 11:39
Martine,bien merci pour votre reponse!Bon week-end!
15 juillet 2011 @ 15:00
« Les Pensées d’une Reine ont popularisé en France le talent et le nom de Carmen Sylva : ce qu’on sait peut-être moins bien de ce côté-ci de la frontière, c’est que la Reine a traduit en allemand deux des plus belles œuvres de la littérature française moderne : „Pêcheur d’Islande”, de Pierre Loti, et „Les Deux Masques”, de Paul de Saint-Victor, et que dans plusieurs de ses écrits – dans „Feldpost” notamment – elle a prêché avec conviction et chaleur la réconciliation de la race germanique et de la race latine qui, à son avis, sont « faites pour se compléter l’une l’autre » et que tout devrait rapprocher. Ces idées d’apaisement, de réconciliation et de la fraternité ont été noblement exprimées par Carmen Sylva dans l’Avant-propos de la traduction de „Pêcheur d’Islande” : „S’il m’était donnée, dit-elle, de pouvoir réconforter par ce petit poème le cœur des lecteurs, comme mon propre cœur a été réconforté par la grandeur biblique et la réalité saisissante de ce récit ; si le mot brutal d’ennemi héréditaire pouvait être remplacé dans quelques bouches allemandes par cette belle expression : pays de frères, alors mon travail aura été facile et ne m’aura donné que joie.” » (G. Bengesco : Carmen Sylva intime, Paris : Librairie Felix Juven, 1905, page 188-189).
Gabriel Badea-Päun: „Les Débuts d’une amitié célèbre” (chapitre XIV, Carmen Sylva et Pierre Loti, page 121-126.
L’édition allemande sous le titre „Carmen Sylva. Königin Elisabeth von Rumänien – eine rheinische Prinzessin auf Rumäniens Thron” suivra au mois d’octobre chez Ibidem Verlag à Stuttgart.
16 juillet 2011 @ 12:35
Merci à Régine pour ce très intéressant article sur une reine méconnue et à Silvia pour ses informations complémentaires concernant le talent littéraire de cette souveraine atypique.
20 février 2021 @ 15:57
Merci infiniment pour ce bel article bien documenté. Quelqu’un sait-il quels liens elle entretenait avec l’écrivain breton Anatole Le Braz (1859-1926) ? Il est connu pour sa magnifique « Légende de la Mort » mais il a écrit bien d’autres ouvrages, dont « Le Sang de la sirène » qui avait beaucoup plus à Carmen Sylva. Elle l’avait sacré « Poète de la mer ». Cette question m’intrigue depuis très longtemps. Merci.